Abiotrophies corticales cérébelleuses

Photo illustrative, ce chien n’est pas malade
Cerebellar cortical abiotrophy
aussi appelée Abiotrophie cérébelleuse, dégénérescence corticale cérébelleuse post-natale
Groupe de maladies caractérisées par une une neurodégénérescence principalement localisée au cortex cérébelleux. Historiquement, le terme le plus couramment utilisé est abiotrophie cérébelleuse. Le mot abiotrophie signifie « absence de substance nutritive », mais on sait désormais que nombre de ces affections résultent de troubles non métaboliques. C’est pourquoi le terme dégénérescence corticale cérébelleuse est aujourd’hui préféré. Ces maladies peuvent être subdivisées en deux groupes : celles affectant principalement les neurones de Purkinje, et celles touchant les neurones granulaires, aussi appelées dégénérescences granuloprivales.
#SYSTÈME NERVEUX
• Races concernées : plusieurs races sont prédisposées, et certaines lignées ont des mutations spécifiques identifiées.
• Signes cliniques précoces : l'ataxie (incoordination motrice), les tremblements d’intention, la démarche hypermétrique, et parfois le nystagmus, apparaissent généralement dès les premières semaines à mois de vie, avec une progression variable selon la race et le type de mutation.
• Diagnostic : il repose sur les signes neurologiques précoces, l’imagerie cérébrale (IRM montrant une atrophie cérébelleuse), et/ou l’examen histopathologique post-mortem. Des tests génétiques sont disponibles pour certaines races.
• Pronostic et traitement : il n’existe pas de traitement curatif ; la maladie est progressive et souvent invalidante. Le pronostic est réservé à sombre, avec euthanasie fréquente en raison de la perte de qualité de vie.
Races prédisposées
Découvrez chaque race en détails sur le portail SCC
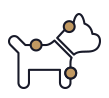
Suspicion
Signes cliniques chez un chien de race prédisposée, apparaissant entre 2 et 3 semaines pour la forme néonatale, jusqu’à 6 mois pour la forme juvénile ou chez un adulte pour la forme tardive.
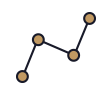
Fréquence
Rare.

Signes cliniques
• Ataxie cérébelleuse : la démarche se caractérise par une hypermétrie (exagération des pas) symétrique, avec des mouvements de flexion excessifs et mal contrôlés, notamment en phase de levée du membre. Elle se différencie de l’ataxie spinocérébelleuse, avec des mouvements plus irréguliers et dansants/ondulants.
• Difficultés à la préhension des aliments.
• Chutes.
• Tremblements intentionnels (très souvent lorsque l’animal mange et/ou boit).
• Déficits proprioceptifs.
• Nystagmus (mouvement rhythmiques et répétitifs des yeux, qui peuvent être déclenché par la manipulation de la tête).
• Clignement à la menace diminué à absent avec une vision normale.
Trois formes possibles (certaines races présentent deux formes, précoces et tardives) :
| Forme néonatale | entre 2 et 3 semaines | Beagle, Caniche Nain, Colley, Samoyède, Setter Irlandais, Chien de Rhodésie à crête dorsale, Podenco portuguais, Jack Russel Terrier, Boxer |
| Forme juvénile | jusqu’à 6 mois | Airedale, Kelpie Australien, Bouvier Bernois, Border Collie, Bulldog anglais, Coton de Tuléar, Chien courant Finlandais, Kerry Blue Terrier, Labrador Retriever, Lagotto Romagnolo, Samoyède, Setter Irlandais, Braque Hongrois à poil court, Fila de Saint Miguel, Schnauzer miniature, Epagneul nain papillon, Collie à poil court/long, Chien de Rouge de Bavière, Chien courant italien à poil ras, Podenco d’Ibiza, Terrier écossais |
| Forme tardive | Labrador Retriever (1-4 ans), Bobtail (>4ans), Border Collie (< 7-13 ans), Epagneul Breton (> 8-10 ans), Setter Gordon (< 4 ans), Berger anglais ancestral (6-40 mois), Terrier écossais (2mois – 6 ans) |
Méthodes de diagnostics
1. Épidémiologie et clinique.
2. Imagerie en coupe par résonance magnétique de l’encéphale : atrophie cérébelleuse.
3. Test génétique (si disponible pour la race considérée).
4. Histologie post mortem: lésions spécifiques retrouvées uniquement au niveau du cervelet:
– Diminution importante du nombre de cellules de Purkinje, les cellules restantes ayant un aspect ballonné, compensée par un nombre important d’astrocytes. Progressivement, atteinte secondaire des autres types cellulaires du cervelet, en particulier des cellules granulaires. Forme observée chez le Bobtail, le Kelpie Australien, le Labrador Retriever, le Setter Gordon, le Setter Irlandais, l’Airedale, le Samoyède, le Chien courant Finlandais, le Beagle, le Chien de Rhodésie à crête dorsale, le Chien de garenne Portugais, le Caniche Nain, le Kerry Blue Terrier, le Schnauzer Miniature, le Braque Hongrois à poil court et le Terrier Ecossais.
– Cellules de Purkinje en quantité et de forme normale mais cellules granulaires diminuées en nombre. Cette forme particulière est appelée « abiotrophie cérébelleuse granuloprive ». Forme observée chez l’Epagneul Breton, le Coton de Tuléar, le Border Collie, le Colley, le Chien courant Italien, le Chien de rouge de Bavière, le Lagotto Romagnolo, le Kelpie Australienet le Bouvier Bernois.
Diagnostic différentiel
• Anomalie de surcharge lysosomale.
• Cérébellite
• Hydrocéphalie.
• Encéphalopathie métabolique.
• Kyste arachnoïdien.
• Hypoplasie cérébelleuse.
• Néoplasie.
• Intoxication.
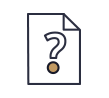
Pronostics
Réservé à mauvais, fonction de l’âge d’apparition et de la rapidité d’aggravation des symptômes. Chez certaines races, l’évolution est plus rapide que d’autres. L’ensemble des données d’évolution connues chez les différentes races peut être retrouvées dans un tableau récapitulatif présent dans cet article : STEE K., Phenotypic and genetic aspects of hereditary ataxia in dogs, 2023
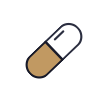
Traitements
Absence de traitement spécifique.

Tableau génétique
| Transmission |
|---|
Transmission héréditaire démontrée / Transmission héréditaire suspectée |
| Mode de transmission |
|---|
Transmission héréditaire autosomique récessive démontrée chez le Beagle, le Kelpie Australien, le Chien courant Finlandais, le Chien de Berger Anglais Ancestral, le Setter Gordon et le Braque Hongrois à poil court. Mode de transmission autosomique récessif suspecté pour les autres races. |
| Le gène muté et sa mutation |
|---|
• Chez le Beagle : Retrouver la fiche maladie sur : • Chez le Kelpie Australien : Retrouver la fiche maladie sur : OMIA / DogWellNet • Chez le Chien courant Finlandais : Retrouver la fiche maladie sur : • Chez le Chien de Berger Anglais Ancestral et le Setter Gordon : Retrouver la fiche maladie sur : • Chez le Braque Hongrois à poil court : Retrouver la fiche maladie sur : • Chez le Terrier écossais : Retrouver la fiche maladie sur : OMIA / DogWellNet • Chez les autres races : pas encore de gène identifié. Retrouver la fiche maladie sur : OMIA / DogWellNet |
| Possibilité d'un test ADN |
|---|
Oui, chez le Beagle, le Chien courant Finlandais, le Setter Gordon et le Berger anglais ancestral, et le Braque hongrois à poil court/ras. |
Conseil aux éleveurs
• Écarter les animaux atteints de la reproduction, dépister par test ADN les reproducteurs et proscrire les accouplements entre hétérozygotes (porteurs sains).
• Pour les races sans test ADN : écarter de la reproduction les animaux atteints et leurs apparentés directs.